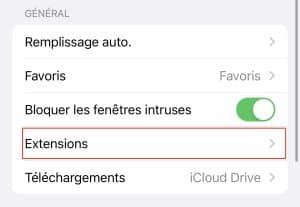Mélissa Thériault – Culture – avril 2021
Gabrielle Filteau-Chiba est traductrice, illustratrice et autrice. À l’occasion de la parution du dernier volet d’une trilogie (Encabanée en 2018, Sauvagines en 2019, puis Bivouac en 2021), La Gazette lui a proposé, par « échange épistolaire moderne », de partager avec nos lecteurs sa vision du rôle de l’artiste en société.

Gabrielle Filteau-Chiba – Crédits : Véronique Kingsley
Q : Votre trilogie se situe dans les régions du Québec et c’est l’une de ses grandes forces : elle nous fait rêver de ces lieux qui sont à la fois si près et si loin de nous. Comment s’est développé votre attachement au territoire ?
R : À 18 ans, j’ai pris l’habitude d’aller me perdre aux quatre coins du monde, en sac à dos, dès que j’avais du temps et des sous. Je me suis installée, toute une session d’études, sur une île africaine, préférant suivre mes cours à distance. J’ai fait du pouce en Roumanie, en Pologne pour errer dans des rues où je me sentirais chez moi. J’ai cueilli des cerises et taillé des vignes. Tout plein de choses piquaient profondément ma curiosité : l’autre, l’inconnu, la nature sauvage d’un autre endroit, les petits cafés, les parias. Les voyages étaient pour moi à la fois une fuite et une quête d’identité. Et donc j’ai voulu devenir traductrice parce que parler plusieurs langues était synonyme d’amitiés, d’alchimie, en voyage. Je tisserais des ponts.
Mais la réalité du métier m’a rattrapée : il fallait passer des journées entières à l’écran et les trois quarts de mon temps en ville. Je me suis vite sentie aliénée. Cumulant les plans d’évasion, je cherchais encore une destination exotique… Puis c’est devenu une évidence. Kamouraska ! L’arrière-pays niché dans les Appalaches, les baleines qui font vibrer la berge, les harfangs sur des piquets de rangs… Dans ma tête pleine de listes, Kamouraska était déjà associée à un fabuleux-fiévreux roman d’Anne Hébert et aux légendes d’une boulangerie aux pieds dans l’eau, de neiges quasi éternelles, des plus beaux couchers de soleil de ce monde et de mammifères marins qui se la coulent douce dans les eaux, s’en retournent sans presse à la mer.
Je n’étais pas riche. Mais j’avais un plan extraordinaire. Tout vendre. Remplir mon char de l’essentiel. Partir vivre dans un refuge de bûcheron des années 1970, repéré sur Centris, abandonné en plein milieu d’une immense forêt d’épinettes. Sans parler de la rivière, de la rivière. J’ai mis tous mes œufs dans ce panier-là : le pari de tenir le plus longtemps possible dans mon shack. Ça a été le voyage le plus beau, le plus long et le plus dépaysant de ma (jeune) vie. Mon premier vrai chez-moi.
De 23 à 26 ans, j’y ai vécu seule, sans eau courante ni électricité. Faux. Il y avait les coyotes dehors. Les souris dans les murs. J’ai adopté une husky, aussi, le deuxième hiver. Et j’avais des livres, des tonnes de livres. Que j’ai lus à voix haute, à la lueur d’une lampe ou d’une chandelle, comme si je parlais à de vieux amis. J’ai tenu un journal, dessiné des traces d’animaux, des flocons, des cocottes, dressé des listes pour rire de moi-même et refaire le monde avec mes nouveaux amis, des écolos et des affranchis du coin.
Finalement, mon périple de huit ans à vivre un peu en ermite dans ma forêt au Kamouraska s’est transformé en une œuvre papier. Trois romans illustrés. Maintenant traduits dans plein de langues. Ça commence par Encabanée, puis Sauvagines et enfin Bivouac. Un triptyque. Je vous prends par la main et vous emmène rencontrer Anouk, Raphaëlle et Riopelle, d’ardents défenseurs du territoire. Des amoureux.
Q : La Mauricie est un tissu formé de villes et d’espaces encore sauvages, malgré un passé industriel important. Elle tient à son caractère régional, bien qu’elle soit située entre la capitale et la métropole.
Vous avez expérimenté la vie dans le Bas-St-Laurent avec ce qu’elle comporte de plus beau et de plus difficile. Croyez-vous que l’on puisse « cultiver la vie sauvage » (si vous me permettez l’oxymore) en ville, c’est-à-dire commencer par l’éducation citoyenne en ville, afin de sortir du clivage métropole/région ? Si oui, par où commencer, si non, pourquoi ?
R : Je crois au nomadisme des humains. Je pense que bouger sur le territoire fait partie de notre ADN. Comme ceux qui vivent en ville et se jettent sur les autoroutes le vendredi pour arriver vite au chalet, au mont de ski, à la yourte louée.
Il faut nouer une relation intime et cyclique avec la Nature, aller respirer les gouttelettes et molécules qui planent dans l’air des boisés. Inspirez-y fort – je n’ai pas besoin de vous décrire le sentiment de soulagement et de bien-être qui s’ensuit. Je ne vous apprends rien : aller dans la nature fait du bien. Alors pour commencer à sortir du clivage métropole-région, il faut créer des passages, des passerelles fauniques, pour la faune, mais aussi pour nous. Des sentiers qui s’ouvrent sur un parc protégé où les animaux règnent. Une piste cyclable qui longe un ruisseau à l’ombre et qui nous permet d’accéder à un belvédère, une plage, un arbre ancien. Une ruelle verte où réapparaissent les crapauds et où poussent des citrouilles. Des touches de couleur et de vie qui donnent envie d’aller plus creux, éventuellement.
Q : Par où commencer pour mettre en œuvre cette transition, selon vous ?
R : Les enfants imitent nos comportements. Alors ne nous réfugions pas en région éloignée seulement quand nous sentons le stress nous tuer à petit feu, allons-y souvent, entourons-nous de plantes, créons des occasions où nous risquons de croiser les beautés rares du territoire. La première fois que j’ai vu, assise dans la chaloupe de mon ami, trois bélugas nager droit vers nous, j’ai pleuré d’émerveillement. Et je me souviens de ce moment comme si c’était hier. Si j’avais un conseil aux parents et aux jeunes adultes qui rushent ces temps-ci, je vous dirais de revisiter la tradition de la quête de vision, durant laquelle l’adolescent passe de l’enfance à l’âge adulte en séjournant un long moment en autonomie en Nature.
Nous avons besoin de rituels pour renouer avec la vie sauvage. C’est un pan de notre humanité que nous avons occulté. Promenez-vous dans les bois. Décrochez un bon bout. Le pire qui peut vous arriver, c’est l’ennui, et après l’ennui, viennent les idées. L’inspiration.
Comme le matin de printemps où j’ai aperçu une loutre à trois pattes jouer dans la rivière, entre les glaces et les cristaux de lumière, scène qui m’a donné envie d’écrire une histoire pour enfants. Parce que le virage vert doit être ludique pour que les petits embarquent.
Q : En terminant, que peut-on vous souhaiter pour la suite ?
R : Que la traduction de mes romans à l’étranger et que mon succès littéraire au Québec (merci du fond du cœur à toutes mes lectrices et à tous mes lecteurs) se matérialisent en une forêt protégée, ici. Avec mes droits d’auteure et en vue d’y exercer une vigie, je veux acheter un boisé d’arbres matures, un écosystème en péril, la plus grande étendue possible, et veiller à sa pérennité. Ma mission de vie, c’est de contourner le système qui s’enfarge dans les fleurs du tapis, perdant un temps considérable, et ce faisant manque à son devoir de protéger ce que nous avons de plus précieux : la vie sauvage, libre, indomptée.
Prenons soin de la Nature, et elle prendra soin de nous.

Trilogie de romans de Gabrielle Filteau-Chiba – Crédits : Véronique Kingsley
PARTIE 2
L’ACTION DIRECTE EST UN REMÈDE EN SOI – suite de l’entretien avec l’autrice Gabrielle Filteau-Chiba
Q : Votre engagement citoyen et environnemental est manifeste et inspirant. Quel conseil aimeriez-vous donner aux personnes qui se désolent de la dégradation de l’environnement et qui ne savent pas par où commencer pour faire une différence ?
R : Prenez une feuille de papier (recyclé) et écrivez-vous une petite mission, que vous afficherez dans la maison, quelque part où vous la verrez tous les jours. Quand vous aurez rempli votre mission, changez de feuille, essayez de relever un nouveau défi. Les enfants adorent ! Ça peut être de petites comme de grandes batailles, mais les plus modestes sont les meilleures au début, parce qu’elles sont réalisables et concrètes. Planter deux pommiers dans la cour. Arroser les plantes et les rempoter en leur parlant avec amour. Récupérer l’eau de pluie pour les oiseaux. Flusher moins souvent. Trouver de beaux bocaux pour du vrac. Faire pousser des légumes sur le balcon. Lancer des bombes de semences sur des terrains vagues. Organiser une corvée de ramassage de déchets dans un cours d’eau. Manger moins de viande. Explorer l’Écocentre et les recycleries de matériaux. Écrire à mon député que je suis déçue de sa vision du monde, de son manque de vision environnementale. Lui envoyer un dessin d’enfant pour lui rappeler que leur avenir compte, aussi. Acheter local, usagé. Donner. Épurer un tiroir par jour, une pièce par semaine. Redistribuer aux amis du quartier, aux organismes de charité. Réparer un objet en particulier. Apprendre à coudre en se faisant un déguisement. Monter un sommet. Se mettre au défi de faire le plus de choses possible à pied, quitte à marcher des heures, c’est bon pour la santé. Cuisiner. Offrir des conserves à une connaissance qui vient d’accoucher. S’abonner à des paniers biologiques. Offrir ses bras à un potager, une cabane à sucre, un chantier écologique. Je pourrais en nommer des milliers d’idées, de petits pas… Le plus important, c’est de commencer dès maintenant et d’avancer, avec indulgence et imperfection, mais d’avancer. Les enfants vous imiteront. Vos amis s’inspireront de votre démarche. L’optimisme est contagieux, et quand on prend sa santé et de celle de la planète en main, on est plus heureux parce qu’on agit. L’action directe est un remède en soi.
Q: Croyez-vous qu’il soit possible de sortir de l’extractivisme tel qu’il se pratique actuellement et que les artistes peuvent jouer un rôle de leadership en ce sens ?
R: Je crois que tout est possible. Que le plus difficile est la prise de conscience et le carcan des habitudes, que le reste suivra. Les marginaux, les artistes, les ermites, les insolites qui ont préféré la liberté au confort, ont de toutes les époques été ceux qui défrichaient. C’est pour cette raison que l’art est si important dans nos vies : l’art a le pouvoir de nous éblouir et de nous rassembler, de nous sensibiliser et de nous motiver. Voulez-vous mille dollars comptant ou pouvoir tous les jours lire à l’ombre d’un arbre de mille ans ? Voulez-vous des marées noires ou des eaux douces où vous baigner et où les enfants de vos enfants attraperont des ménés ? Je pense que les artistes doivent jouer leur rôle d’éclaireuses et d’éclaireurs, mais qu’il manque aussi de porte-voix pour que leur message soit bien entendu.
Je vous remercie pour vos questions, d’ailleurs, qui nous permettent de parler de société, d’environnement et d’art en même temps.
J’ai lu un excellent essai sur l’extractivisme que je recommande à ceux qui aimeraient pousser la réflexion plus loin : La lutte pour le territoire québécois – entre extractivisme et écocitoyenneté de Bruno Massé. On y apprend entre autres comment ne pas tomber dans les pièges du développement durable et orchestrer intelligemment nos combats pour la suite du monde.
Q : Nous aurons à discuter collectivement d’une question aussi importante que délicate quant au partage du territoire et à la cohabitation sur celui-ci entre les populations autochtones et allochtones, qui est souvent résumée par l’expression « land back ». Par où commencer pour penser une nouvelle forme de cohabitation ? Avez-vous eu à débattre de ces questions ou à y réfléchir dans le cadre de votre processus d’écriture ?
R : La souveraineté est un principe qui me guide. J’en rêve, d’un pays, avec nos frères et sœurs des Premières Nations. Je rêve que toutes les écoles du Québec enseignent au moins une de leurs langues. Que le territoire et ses ressources soient respectueusement gérés de façon collaborative, où des redevances leur reviendraient. Je rêve d’un territoire partagé où les Aînés seraient écoutés et invités en tant que sages dans toutes les discussions.
Dans l’expression « land back », je lis aussi : le droit à une vie digne. À l’équité. Poussons l’audace en commençant par la toponymie et par un ministre de l’Environnement issu des Premières Nations, pour une véritable intendance durable de notre sublime territoire qui se fait saccager par l’industrie. Nous savons bien que dans la Nature, la collaboration est plus forte que la prédation. Passons du mode prédateur au mode consensuel.